
Les livres Saints, quelle que soit la confession, ont ceci d’irréfutable. Ils sont, bien souvent, remplis d’enseignements. Ce qui suit en est un. Il affleure à l’aune du dernier repas que Jésus eut avec ses disciples. C’est un récit du 13 -ème chapitre de l’Évangile de Jean, verset 1 à 17.
La veille de Pâques, Jésus[1] sait que le grand moment arrive pour lui : il doit quitter ce monde et aller auprès de son Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu’au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. Pendant ce temps, l’esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l’intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu et il va auprès de Dieu. Jésus sait cela, et il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains.
Pendant le repas, Jésus se lève. Il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l’eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu’il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre. Il s’en suit la discussion suivante :
- Pierre : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? »
- Jésus : « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. »
- Pierre : « Non ! Tu ne me laveras jamais les pieds ! »
- Jésus : « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. »
- Pierre : « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »
- Jésus : « Celui qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. »
Jésus savait déjà qui va le livrer, c’est pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement, s’assoit et leur dit ceci :
« Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”. Vous avez raison : je suis Maître et Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple : ce que je vous ai fait, faites-le-vous aussi. Oui, je vous le dis, c’est la vérité : le serviteur n’est pas plus important que son maître, l’envoyé n’est pas plus important que celui qui l’envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. »
Fin du récit.
Moralité : La plupart des sociétés est régie par une population qui élit ses gouvernants. Ces dirigeants, dans la mesure où ils décident des orientations et des lois pour « assurer un bien-être social », pourraient être considérés comme des maîtres. Jésus, ici, s'applique à montrer le sens de la hiérarchie et instaure un principe de gouvernance : tout dirigeant qui souhaite obtenir un véritable honneur de son peuple devrait commencer par le servir véritablement et prendre en considération ses aspirations profondes. Ainsi soit-il !
[1] Fils de Dieu pour le christianisme, prophète pour d’autres et un simple personnage pour plusieurs autres encore : tout cela importe peu ici. C’est l’enseignement à retirer de ce récit qui compte.
Lire la publication entière

Le développement effectif du continent africain est tributaire de l’unicité de ses pays. Un véritable empire africain, au moins en Afrique subsaharienne, ne revêt plus un caractère éclectique. Il s’impose. Il ne peut pas en être autrement. De Kwame Nkrumah à… Gervais Koffi Djondo : la thèse de l’unité de l’Afrique n’a jamais manqué de fervents défenseurs. C’est encore moins Cheick Anta Diop qui prendrait le contrepied de l’idée d’une telle union. En effet, ce dernier avait posé les bases de cette éventualité dans un texte-programme dès 1960. Personnellement, je ne suis pas moins convaincu de cette nécessité, aujourd’hui.
Si la thèse de l’unité africaine fait l’objet d’une plus grande adhésion, quelle doit en être la base ?
Une vision à la fois purement idéologique, historique et culturelle domine les discours. Manifestement elle l’est moins. Elle consiste à dire ceci : « parce que nous (africains subsahariens) partagerions une identité historique et culturelle, alors nous devrions, incessamment, nous unir. »
Cheick Anta Diop, à maintes reprise, s’est attelé à une élucidation très fine de la quintessence de cette vision (lire, par exemple, les premières pages de son ouvrage[1]). Cette vision, néanmoins, repose essentiellement sur une unité et un rapprochement des peuples par les traditions, la civilisation commune, la linguistique.
Sans tomber dans l'iconoclasme, je me pose une question non moins essentielle : aujourd’hui, factuellement, pour quelles raisons un habitant d’une région spécifique du Niger chercherait à s’exprimer dans une même langue qu’un autre habitant du Bénin ou du Nigéria ? Seulement, pour des raisons historiques et culturelles ? Autrement dit, ces derniers motifs sont-ils suffisants pour impulser une unité africaine ?
L’on pourrait également s’interroger sur les motivations réelles d’une solidarité effective entre les États africains - l’union politique en serait la forme la plus aboutie. Une fois encore, seulement pour une raison de « destin commun » ? D’ailleurs, l’absence d’une solidarité budgétaire effective n’est pas un phénomène rare au sein des différentes organisations régionales.
Le choix des trois pays précédents n’est pas un pur hasard. En effet, ces trois pays sont contigus. Maintenant, supposons l’existence d’un marché d’échange de biens et services au croisement de ces 3 pays, profitable pour tous. Il semblerait que les populations, naturellement, émettront le désir de se comprendre vocalement et y consacreront les moyens adéquats.
De cela découle une conséquence importante pour la stratégie voire peut-être pour le sens de la causalité de l’unité africaine. Au-delà des considérations idéologique-historique-culturelle, un élément fondamental qui suscite l’intérêt de chacun et bénéfique pour tous devrait permettre d’atteindre une unité tangible : peut-être le marché africain.
Le cas échéant, les premiers clients et fournisseurs de chaque participant au marché doivent être sur le marché. L’interconnexion entraînerait un contrat de solidarité implicite et d’autres externalités pour la consolidation de l’unité. Puisque dans un souci de préservation de ses intérêts, chaque participant au marché serait en mesure de fournir des efforts supplémentaires sur d’autres aspects connexes pour préserver la stabilité du marché. Ces externalités peuvent prendre la forme d’un effort pour garantir la paix et la sécurité, donc la défense des territoires.
Lire la publication entière

Devant un climat de plus en plus menaçant, et des villes africaines impréparées aux effets multiples du réchauffement planétaire, la ville durable apparaît comme une porte de sortie. Sa nécessité essentielle s’impose tacitement à une Afrique balbutiante.
Les challenges urbains africains, pour multiples qu’ils soient, n’ont rien de pavillonnaire, in extenso, s’ils sont observés de l’intérieur, d’où qu’on regarde. Les liens consubstantiels entre absence ou insuffisance de politiques, déficit de prospective, immaturité de l’action commune, éducation environnementale inexistante ou inaboutie vis-à-vis des enjeux et vulnérabilités croissantes relèvent l’importance de marquer un temps d’arrêt et d’envisager de nouvelles solutions.
Entendre un nouveau son de cloche
Pour négocier le nécessaire virage de la ville durable, l’urbain africain doit cocher durablement la case de la réhabilitation de la conscience écologique, jadis, motrice du fonctionnement intrinsèque des sociétés africaines. C’est du fait de cet impératif fondamental que le plaidoyer “Ma patrie c’est la ville durable”, initié par l’association Construire pour demain vise non seulement à transmettre des connaissances mais aussi à susciter un intérêt marqué pour le sujet de villes durables, incontournable pour construire une Afrique qui résiste au changement climatique.
Construire cette Afrique, c’est avant tout l’imaginer ensemble et la porter comme une initiative commune. C’est surtout réussir à faire foule autour de l’obligation qui nous étreint et nous impose, sans délai, le rassemblement. De fait, la nécessité de révéler les challenges apparemment pavillonnaires, tout en étant latents, mais, au fond, cohérents, qui déforment l’appréhension correcte du défi global que représente la ville durable en Afrique est apparue manifeste. D’où cette initiative à cent, qui a mobilisé des participants des quatre coins du monde, conscients des urgences, choisissant d’explorer d’autres chemins de la sensibilisation, fermement volontaires et unis par un désir partagé d’avenir, dans l’unique but de dire. Pourquoi ? Parce que la réalité commence au récit.
Du récit à l’action commune
Dès lors que le plaidoyer informe, par une esquisse des principaux enjeux urbains africains, sous réserve des particularités inhérentes à chaque ville, il répond à un besoin de démocratisation des savoirs sur le sujet. Dès lors qu’il trace les chemins de l’introspection, il réhausse les possibles des solutions endogènes. Dès lors qu’il théorise la ville-patrie et postule que l’engagement de chacun est le point de départ de l’action de tous, en magnifiant l’essence transformatrice de l’action de proximité, il offre une perspective décisive. Ainsi, le but de cette initiative est de féconder les esprits et de stimuler une effervescence collective qui se traduirait dans les actes, par une métamorphose de l’urbain.
L’enjeu de cette initiative se singularise par l’attachement à l’exemple, lequel s’est marqué par l’association des volontés au-delà des frontières africaines. Cela dénote de la possibilité intramuros de consolider dans les faits, la fabrique africaine de la ville durable, sous l’éclairage des politiques urbaines et le leadership des habitants, avant celui des décideurs. Le lien qui unit l’habitant à sa cité est une figure de l’appartenance. Cette appartenance est un sentiment qui imprime une âme à ceux qui l’incarnent. Elle unit, certes, mais requiert surtout. Ainsi, elle impose un devoir au citadin. Celui de construire, d’éduquer et d’espérer. Parce que la ville est une promesse.
Lire la publication entière

Les contraintes et l’inégale répartition auxquelles font face les villes africaines en termes d’infrastructures et équipements de base, constituent le point de départ d’une foultitude de défis qui les tiennent en joue, faisant de la question urbaine une urgence permanente qui remet en cause nos modèles de développement. Et si le nœud du problème se trouvait dans la relation ville-campagne ?
Charles Becker et Andrew Morisson, avançaient dans une étude en date de 1998 que l’augmentation de la population urbaine n’était imputable à la croissance de l’emploi que pour un volume de 10%, preuve que l’arrivée massive des migrants en ville favorise/favorisait davantage l’évolution du secteur informel. Porte de sortie pour les nombreux jeunes chômeurs qui arrivent en ville, mais également phénomène à combattre ; l’économie informelle est également le symbole d’une insertion difficile en milieu urbain, dans un monde aux flux migratoire intensifs en direction des villes. L’accès au travail, la constitution d’un ménage et l’accès au logement ; principales composantes de l’insertion ne sont pas systématiquement garanties d’où l’importance des réseaux familiaux et du capital social pour accéder au logement et à l’emploi, ainsi que pour stimuler l’ascension sociale en milieu urbain.
Jauger les dynamiques urbaines
Devant faire face à leur croissance naturelle, mais aussi à la pression migratoire, les villes ne sont plus en mesure de satisfaire les besoins de leurs natifs et des migrants. La ruralisation, accentuée par le double effet des programmes d’ajustement structurels (à travers la réduction du pouvoir d’achat des populations ainsi que des dépenses sociales) et de l’immigration des ruraux, laisse des traces encore visibles (plus dans les villes secondaires que dans les capitales). Cela pose la double question de l’amélioration de la qualité de vie dans les zones urbanisées et, celle plus profonde, de « la capacité politique de la ville à faire société ».
En effet, la ville n’est plus qu’une question économique et industrielle, simplement adossée à la nécessité de l’aménagement, mais bien une question sociale. Cela traduit en fait la difficulté des milieux urbains à créer une réelle société, car la ville est le lieu de nombreuses discriminations et de l’accroissement des bidonvilles ; mais également le territoire d’un embourgeoisement qui marque et accentue le distinguo entre les différentes classes sociales.
Il apparaît donc fondamental, de ce point de vue, de limiter la pression migratoire, pour accentuer les possibles de la ville en matière de maîtrise de l’urbanisation, et par voie de conséquence, d’amélioration des conditions de vie des populations urbaines. L’anéantissement de « l’avantage urbain » apparait ici être une approche idéale. En effet, comme l’a démontré Nathan Keyfitz, cet avantage urbain (urban bias) contribue à l’auto-alimentation de l’exode rural dans une boucle de rétroaction positive. Les conditions de vie avantageuses en ville et la disponibilité d’infrastructures adéquates et d’équipements collectifs attirent les ruraux vers les villes, ce qui accroît les migrations et le poids démographique des lieux d’accueil. Cela a de ce fait pour corollaire d’intensifier le poids politique des citadins. La ville est ainsi favorisée par le pouvoir politique, ce qui crée un nouvel avantage urbain et incite à de nouvelles migrations.
Créer la ville à la campagne
Pour briser ce cycle auto-entretenu, il incombe aux gouvernements de créer un meilleur équilibre entre villes et campagnes pour freiner l’exode rural. Il est vrai qu’en Afrique les marges de manœuvres sont limitées du fait de multiples contraintes politiques et administratifs. Toutefois, pour une meilleure gestion de l’urbanisation africaine, spécifiquement dans une perspective de développement durable, il est impératif de mettre en place des mécanismes de régulation ou d’auto-régulation.
Cela pose toute la question des politiques qui conviennent au développement durable des villes africaines. Les mesures de déguerpissement ayant montré leurs limites, il reste important d’agir davantage en faveur d’une meilleure planification familiale et de l’élévation du statut des femmes, tout en accordant plus de ressources au profit du développement rural et en veillant à instaurer un équilibre dans la disponibilité des services sociaux en ville comme au village. Le développement des villes secondaires pourrait d’ailleurs faire office de premier filtre pour une meilleure gestion de l’urbanisation, une sorte de sas intermédiaire censée freiner la ruée vers les capitales. L’enseignement et la formation, à destination du développement des métiers occupant principalement les ruraux, reste un levier principal dans l’émulation et le maintien d’activités visant au développement rural.
À l’heure où s’accroissent les bidonvilles en Afrique, le surpeuplement des logements est une tendance lourde dans de nombreuses aires urbaines. La pauvreté et les conditions de vie des populations s’accentuent davantage. Il nous faut réinventer l’urbain. Gageons que le développement des villages représente une part non négligeable de la solution.
Lire la publication entière

Qu’est-ce qui justifie cette opulence qui s’étend jusqu’aux rangs les plus bas du peuple à certains endroits du monde ? ..et l'Afrique ?
Bonne interrogation.
Considérons deux états des choses.
Le premier. Il est une contrée avec une économie primitive de collecte - c’est-à-dire d’acquisition des biens primaires (ou de premier ordre) naturellement disponibles. On associe, souvent, les biens primaires aux ressources naturelles ; qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage, des extractions et de tous ceux peu transformés ou semi-transformés mais qui ne visent pas à produire d'autres biens dans le système d'exploitation productive et économique. Dans cette contrée, la plupart des tâches sont réparties de la manière la plus efficace entre les habitants de la contrée. Certains sont des chasseurs, d’autres des pêcheurs et d’autres encore s’occupent exclusivement de la collecte de végétaux sauvages. La répartition des tâches peut être plus prononcée, de sorte que chaque tâche distincte soit accomplie par un membre spécialisé de la contrée.
Dans cette configuration, deux options sont envisageables. Soit, la contrée obtient le même résultat avec moins d’effort individuel. Soit, en fournissant le même effort, elle atteint un résultat supérieur à la situation de départ. Dans le second cas, les conditions des habitants de la contrée s’amélioreraient grâce à la répartition efficace et plus adaptée des tâches professionnelles. Mais c’est du Adam Smith[1] ça ! Oui bien sûr...
Dans le second état, les habitants de la contrée, par coïncidence divine, deviennent plus ambitieux. Ils ne veulent plus limiter leurs activités aux tâches d’une économie primitive de collecte. Ils souhaitent, désormais, consommés des biens du troisième, quatrième ordre et, plus généralement, des ordres supérieurs. Si les habitants de la contrée associent, graduellement, la satisfaction de leurs besoins à des biens d’ordre toujours plus élevé et si cela s’accompagne toujours d’une répartition plus efficace des tâches, alors leur bien-être croîtrait également. Admettons cela. Le chasseur passe de la chasse du gibier à l’aide d’une massue à la chasse à l’arc et au filet, à l’élevage le plus simple, et successivement à l’élevage intensif. Ceux qui vivaient de plantes sauvages migrent progressivement vers une agriculture intensive. L’industrie manufacturière émerge et s’améliore au moyen d’outils et de machines toujours plus performants. Le bien-être des habitants augmenterait, sans aucun doute, avec ces développements. Plus la contrée progresse dans cette direction, plus les types de biens disponibles sont variés, plus les occupations sont variées, et plus la répartition progressive du travail est nécessaire et rentable.
En effet, dans sa forme la plus primitive, l’économie de collecte se limite à rassembler les biens de moindre importance que la nature offre par hasard aux habitants de la contrée. Comme les individus n’ont aucune influence sur la production de ces biens, leur origine est indépendante des désirs et des besoins des humains.
Dès lors que les habitants s’affranchissent de cette forme d’économie primitive et recherchent des manières de combiner les choses dans un processus causal pour produire des biens de consommation, acquièrent des choses capables d’être combinées et les traitent comme des biens supérieurs, alors ils obtiendront des biens de consommation qui sont aussi véritablement les résultats de processus naturels que les biens de consommation d’une économie primitive de collecte, mais dont les quantités disponibles ne sont plus indépendantes de leurs désirs et besoins. Au contraire, les quantités des biens de consommation seront déterminées par un processus qu’ils gouvernent et régulent par des objectifs humains dans les limites fixées par les lois naturelles.
Les biens de consommations, autrefois, résultants d’un concours accidentel des circonstances de leur origine, deviennent des produits de la volonté humaine, sous la contrainte des lois naturelles ; aussitôt que les habitants ont reconnu ces circonstances et obtenu leur contrôle. Les quantités de biens de consommation dont les habitants disposent ne sont limitées que par l’étendue de la connaissance humaine des liens de causalité entre les choses, et par l’étendue du contrôle humain sur ces choses.
La compréhension croissante des liens de causalité entre les choses et le bien-être humain, et le contrôle croissant des conditions moins immédiatement responsables du bien-être humain, conduisent donc l’humanité d’un état de barbarie et de misère profonde à son stade actuel de civilisation et de bien-être, et ont transformé de vastes régions habitées par quelques hommes misérables et excessivement pauvres en pays civilisés densément peuplés.
Rien n’est plus certain que le degré du progrès économique de l’humanité soit encore, dans les époques futures, proportionné au degré des connaissances humaines, dixit Carl Menger[2].
Certes, c’est une nouvelle réjouissante pour les pays d’Afrique en quête de développement. Ces derniers gagneraient à pondérer davantage sur cet enseignement de Carl Menger en investissant pour un système éducatif plus performant. Car, la connaissance s’acquiert dans les temples du savoir (les écoles, les universités) et progresse avec la recherche et le développement dans les centres et les laboratoires de recherche.
Néanmoins, elle n’est rien d’autre que du vieux vin recyclé dans une bouteille neuve : c’est du déjà connu...
Lire la publication entière

Citez-moi un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé ? Outre certains pays faiblement peuplés, vous ne trouverez point de pays développé qui ne soit pas un pays industrialisé. Cela prouve à quel point l’industrialisation est une condition sine qua non au développement économique durable.
Les dirigeants actuels des pays africains le savent. Ceux qui les ont précédés en avaient conscience. Malgré cela, 60 ans après les indépendances, il y a très peu de pays africains qui peuvent se targuer d’avoir mené une politique industrielle efficace au point de rivaliser avec les géants de ce monde. La question qui nous vient à l’esprit est simple. Pourquoi ces pays continuent de vivre principalement sur la vente de cacao, de coton, d’arachides qui rapportent bien moins que des smartphones, climatiseurs et autres ? Pourquoi se limiter à la vente de cacao en lieu et place d’une tablette de chocolat où la marge de bénéfice est plus élevée ?
Il faut d’abord rappeler que c’est au début du 19e siècle que l’activité économique des pays occidentaux changent fondamentalement. L’économie de l’Angleterre et de la France changent de nature en quelques décennies. Ces pays passent d’une économie agraire à une économie fondée sur la commercialisation de produits manufacturés. Les Etats-Unis ainsi que l’Allemagne suivront le pas, puis le Japon et la Russie au début du 20e siècle. Ces changements opérés il y a près de 200 ans, constituent une des forces majeures des économies des grands pays aujourd’hui développés.
En suivant l’exemple occidental, les dragons asiatiques ont adapté le modèle de révolution industrielle à leur réalité à partir des années 1950. Dès l’indépendance, certains pays africains comme le Ghana ou la Zambie décident également d’industrialiser leur économie. Mais c’est en observant le succès sud-coréen et les tentatives africaines que nous trouvons un début d’explication des échecs du continent africain en la matière.
Les pays africains, au lendemain des indépendances, ont voulu substituer les importations par la production manufacturière. Ils ont ainsi appliqué, dès 1960, des politiques s’appuyant sur le contrôle de change, les taxes à l’importation, des quotas et des subventions publiques. Ainsi, le Ghana entreprend de produire de l’acier et de l’aluminium par exemple. Le pays met en vigueur un code de l’investissement qui prévoit une promotion des entreprises locales. Ces politiques ont permis une hausse de la production manufacturière sans pour autant permettre l’accumulation des bénéfices escomptés. Constatant cet échec, les pays africains abandonnent l’idée d’un protectionnisme et embrassent le « tout libéral », conforté par les Politiques d’Ajustement Structurels du Fonds Monétaire International (FMI) et les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 1995. Et depuis les années 1980, les firmes occidentales se sont confortablement installées dans les pays africains de sorte que dans un pays comme la Côte d’Ivoire, les entreprises françaises représentent aujourd’hui 30% de l’économie[1].
En somme, ce virage stratégique brutal constitue le fondement de l’échec industriel des pays africains. Il résulte malheureusement d’une mauvaise application de la stratégie de substitution de produits étrangers manufacturés. Les pays africains ont ouvert leur marché sans attendre d’avoir constitué des conglomérats solides et prêts à l’exportation. Cette libéralisation précoce a entrainé une désindustrialisation massive des pays africains à partir des années 1980. Les entreprises locales ne peuvent se développer si le marché est déjà occupé par les entreprises de pays plus avancés. Aujourd’hui par exemple, comment un acteur local qui décide de se lancer dans la production de smartphone peut-il du jour au lendemain concurrencer aisément un géant comme Apple ?
L’économiste Friedrich List expliquait déjà au 19e siècle qu’il faut un protectionnisme éducateur avec pour objectif de protéger sur le moyen terme le marché national afin de permettre sur le long terme un libre-échange qui ne soit pas à sens unique. Ainsi, la réouverture complète au libre échange des pays africains ne doit se faire que lorsque ces pays atteignent une certaine maturité industrielle, et commencent à exporter leurs produits manufacturiers.
C’est ainsi qu’a fonctionné la Corée du Sud. A la fin des années 1960, le revenu par habitant était à peu près le même qu’au Ghana. Mais aujourd’hui, celui de la Corée du Sud est 14 fois plus important.
La Corée du Sud a procédé en 4 étapes. Tout comme les pays africains, elle a, d’abord, impulsé dans les années 1950 une substitution de la production étrangère par une production locale pour l’industrie légère. Puis, lors d’une deuxième étape, la Corée du Sud appuie sa stratégie sur la promotion des exportations des produits finis de l’industrie légère dès 1960. C’est ici toute la différence avec les Etats africains, lesquels n’avaient guère instauré une promotion des exportations comme l’expliquent les économistes Bigsten et Söderbom.
Puis, lors d’une troisième phase, pendant que l’industrie légère se développait, la Corée du Sud crée un partenariat solide avec des banques pour maîtriser le capital et financer sans limite des conglomérats nationaux tels que Hyundai, LG, Samsung. Ces firmes bénéficient des avantages financiers et fiscaux. C’est cette troisième étape de la stratégie que les pays africains ont aussi négligée : créer des champions qui doivent briller à l’international tout en maîtrisant l’outil bancaire et financier national.
Ce n’est qu’en 1984 que le gouvernement sud-coréen commence à supprimer les règlementations trop strictes et à libéraliser complètement l’économie. Pendant ce temps, des géants tels que Hyundai, Samsung, Daewoo commencent à s’imposer dans l’économie mondiale. Ces entreprises sont le fer de lance d’un pays qui s’est industrialisé.
C’est en embrassant une vision stratégique de long terme comme celle-ci que les pays africains pourront à terme passer de pays sous-développés à pays émergents. C’est le chemin que prends le Ghana depuis 2016 avec le programme « One district – One factory » (Un district – Une usine). Ce programme vise à créer une grande usine dans chaque district du pays pour atteindre un total de 232 usines à termes ; dont 70 seraient déjà effectifs selon le gouvernement ghanéen. L’industrie automobile est l’un des poumons du projet national. L’objectif, quoique ambitieux mais pas utopique, est d’inonder les routes de Bombay, Sao Paulo ou encore Paris de véhicules made in Ghana (ou plus exactement Kantanka, une marque automobile ghanéenne) dans les prochaines années. En bref, il s’agit tout simplement de conquérir les marchés internationaux. Pour soutenir le projet, le Ghana prévoit une augmentation de 20% à 35% des taxes sur les véhicules importés afin de protéger son industrie naissante.
C’est en adoptant cette vision d’industrialisation échelonnée (déclinée par étapes) avec à terme la transition vers les technologies de pointe que les pays africains pourront, eux aussi, connaître un vrai développement. Ce n’est pas en installant chaque année des industries étrangères qu’un pays accroît son industrie et sa richesse. Le PIB n’est pas le bon thermomètre car il englobe la production étrangère. Les pays africains doivent plutôt chercher à accroître leur Produit National Brut (PNB) en priorité, car les entreprises étrangères finissent toujours par transférer leurs revenus dans leurs pays d’origine. Selon un rapport de la Banque Africaine de Développement et du GFI, l’Afrique aurait transféré à l’étranger près de 1400 milliards de dollars entre 1980 et 2009, ce qui équivaut à un transfert annuel net de 47 milliards par an dans le cadre de flux illicites de capitaux.
En somme, c’est un changement de paradigme qui doit être opéré. Les pays africains ne doivent plus craindre de promouvoir des champions locaux capables de s’imposer à Londres, New-York ou Shangaï.
[1]Selon la Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Côte d'Ivoire (CCIFCI), les entreprises françaises représentent un tiers du PIB du pays
Lire la publication entière

Une chose est observée lors d’une crise. Les conséquences. Une autre chose a tendance à être occultée. La crise n’est que la résultante d’une accumulation de vulnérabilités antérieures, parfois enfouies. Ceci dit, chaque crise survient avec des impacts, certes. Mais fort heureusement, ils ne sont pas uniquement négatifs. Il y a également des enseignements. Dès lors, la responsabilité incombe aux différents acteurs d’en tirer des leçons pour anticiper sur le futur.
C’est au crépuscule de la crise de covid-19 qu’affleure la crise en Ukraine, laquelle est assez révélatrice pour le marché continental de libre-échange africain en perspective.
Dans le sillage de la crise en Ukraine les analyses abondantes sur le décryptage des effets potentiels pour les économies africaines soulignent une dépendance aux céréales russes et ukrainiennes - 30 % du blé consommé en Afrique provient de la Russie. Parmi les pays les plus exposés, le Bénin importe la totalité de sa consommation de blé de la Russie, le Rwanda en importe 60% du même pays pendant qu’au Sénégal 60% du blé consommé provient de la Russie et de l’Ukraine, en Egypte environ 80% du blé est fournie par ces deux pays. Qui plus est, presqu’aucun pays en Afrique de l’Ouest ne produit d’engrais, lesquels sont indispensables pour l’agriculture domestique. Le Nigéria qui fait l’exception exporte l’essentielle de sa production hors du contient.
Ce double constat revivifie un débat persistant sur la nécessité de l’indépendance alimentaire directe et indirecte (via les engrais) des pays du contient vis-à-vis de l’occident et des autres régions du monde. Mais plus important, il donne, par ailleurs des indications importantes pour le marché de libre-échange africain en perspective. Eu égard à la faiblesse du commerce intra africain estimé à moins de 20% du commerce mondiale environ malgré le potentiel du marché africain (un milliard de consommateurs à l’horizon), le marché commun continental est perçu comme la solution pour renforcer le commerce africain.
A l’aune de l’actualité contemporaine de la crise en Ukraine, il serait, cependant, préjudiciable pour les économies africaines d’ouvrir un marché de cette taille avec une production piètre, sans un développement des chaînes de valeur régionale. Bien que la science économique ait suffisamment documenté les avantages du développement commercial, une chose ne doit pas nous échapper. En principe on échange, ex post, des biens fabriqués ex ante. Mais les pays d'Afrique font très peu de transformations et dépendent du reste du monde pour leur consommation.
Par exemple, en moyenne 81,8% des importations de la région sub-saharienne provenaient du reste du monde (hors Afrique). Environ 19,1% du total de ces importations sont en provenance de la Chine, 15% de la zone Euro. Les produits manufacturiers représentent en moyenne 65% de ces importations. Le graphique suivant fournit une décomposition de ses importations de 2010 à 2019.
Figure : Décomposition des importations (en %)
Source : Banque Mondiale/ CJEA
Si les pays africains maintiennent leur configuration actuelle d’importateurs nets de produits manufacturés, le marché continental risque de servir de débouché pour les produits manufacturés en provenance d’autres régions, notamment de l’Asie au détriment du Made in Africa. Il suffit d’un dumping des produits de qualité inférieur à bas coûts en provenance de l’extérieur pour saper l’industrialisation du continent et compromettre définitivement la compétitivité des produits locaux qui pâtissent déjà de mauvaises conditions en termes d’infrastructures énergétique et routière.
Lire la publication entière
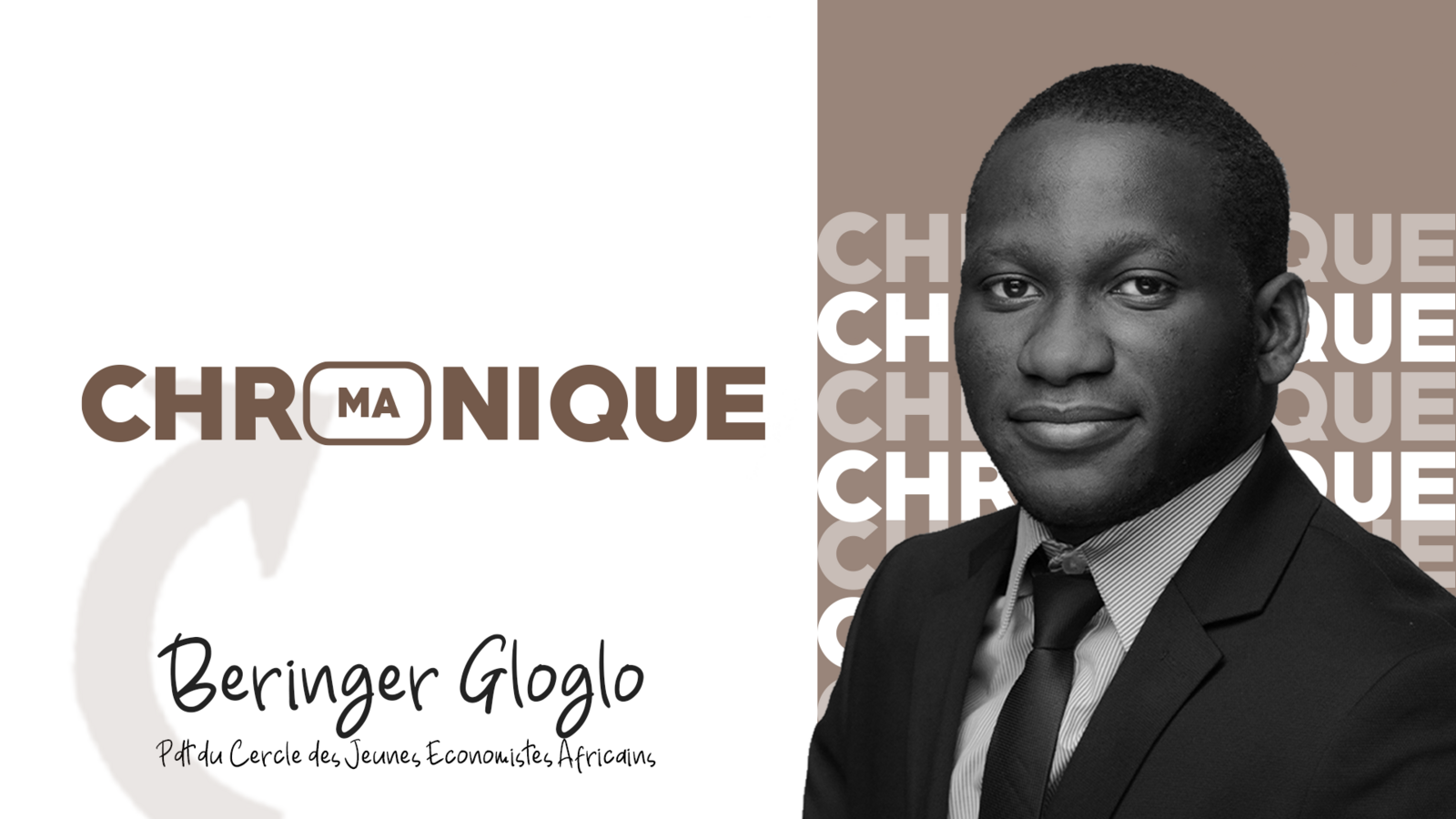
Commençons avec une pensée de l’avocat Fidel Castro (1926). Mais soyons rassurés, je ne veux en aucun cas me faire le chantre d’un homme politique ni de la révolution Cubaine. Loin de là, je veux simplement lancer un appel du cœur à la jeunesse africaine.
Alors qu’il plaidait à son procès au tribunal d’urgence de Santiago le 16 octobre 1953, Fidel Castro, dans un long discours où il laisse transparaître les grands axes de son programme politique, dit ceci :
A lui, ce peuple dont les routes pleines d’angoisses sont pavées de tromperies et de fausses promesses, nous n’allions pas dire : «Nous te donnerons un jour», mais : «Tiens, prends, et lutte de toutes tes forces pour conquérir la liberté et le bonheur !»
Plus tôt, l’homme à la fois l’accusé et son propre défenseur (avocat) venait de dresser une liste des maux dont souffrait le peuple cubain d’alors : chômage endémique, corruption, misère, cadre et condition indécentes de travail et de vie, etc. Vu sous cet angle le Cuba d’alors serait assimilable à l’Afrique d’aujourd’hui. En 2015, la Banque africaine de développement a estimé que la corruption fait perdre l’équivalent de 148 milliards de dollars à l’Afrique chaque année. A titre comparatif, lors du sommet de Paris (mai 2021), seulement 34 milliards de dollars des droits de tirages spéciaux du FMI ont été affectés à l’Afrique pour la gestion de la crise du coronavirus. Mais n’exagérons rien. L’Afrique, dans les chiffres, a aussi fait des progrès. La croissance économique y est soutenue et s’établit en moyenne à 4% - 6% depuis plusieurs années (avant covid-19). Cependant, ayons l’honnêteté de reconnaître les importants efforts qu’il reste à fournir.
A l’époque, Fidel Castro appelait le peuple cubain à la responsabilisation, si, ce dernier aspirait vraiment à un lendemain meilleur. Aujourd’hui, c’est ce même appel à la responsabilité que je veux lancer à la jeunesse africaine, dont je fais partie intégrante. Bien que ce soit une honte de vouloir me hisser au rang de cet homme de droit, je m’en voudrais tout de même de ne pas exprimer clairement ma pensée. La jeunesse africaine doit, elle aussi, aujourd’hui prendre ses responsabilités. Toutefois, les contextes sont différents, et bien heureusement. Il ne s’agit pas pour la jeunesse africaine d’organiser, au prix de son sang, une «guérilla», mais de se prémunir contre une forme gravissime et mortifère d’impéritie dont la conséquence sera des nations aux rues jonchées de «kakistocrates».
A ce stade, d’aucuns, sans hésitation évoqueront le combat des panafricains et iront jusqu’à leur confier le destin de l’Afrique. Ils ont raison. En effet, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Ahmed Sékou Touré, Jomo Kenyatta, par leur militantisme indépendantiste, ont posé une base pour une Afrique prospère. C’est après cette vague que s’installe toute la désillusion. Soixante-et-un (61) ans après l’accession à l’indépendance du pouvoir colonial, on s’interroge encore sur le destin de l’historique discours panafricaniste «L'Afrique doit s'unir. Unis nous résistons», prononcé par le docteur Asagyesfo Kwame Nkrumah au sommet de l’ancienne Organisation de l'Unité Africaine (OUA) à Addis-Abeba, le 24 Mai 1963. En tout cas, il y a une certitude. L’Afrique ne dispose pas d’une monnaie unique commune. Le marché commun africain n’est pas totalement effectif, encore faudrait-il une cohésion au niveau des marchés sous régionaux existants. Il n’existe pas non plus de système continental de télécommunication ni de défense. L’Afrique n’a pas une stratégie diplomatique commune à l’étranger. Peut-être que certains ont eu raison de penser que le «Nkrumahism» et ses ambitions n’étaient qu’une utopie et n’avaient que pour seul but le culte de la personnalité de Nkrumah.
Une chose est sûr, ce n’est ni le moment ni l’endroit pour refaire l’histoire. D’ailleurs, ce n’est pas la meilleure stratégie pour sortir les 250 millions d’africains sous-alimentés de la famine. L'Afrique est la deuxième région du monde qui concentre le plus grand nombre de personnes sous-alimentées, après l’Asie (381 millions). L'Amérique latine et les Caraïbes clôturent le classement (48 millions). Mais en pourcentage, l'Afrique est de loin la région la plus impactée par le fléau de la famine. Dix-neuf virgule un pour cent (19,1 %) de sa population est sous-alimentée. Ce taux est plus de deux fois supérieur à ceux de l'Asie (8,3 %) et de l'Amérique latine et des Caraïbes (7,4 %). Si la tendance actuelle se poursuit, en 2030, l'Afrique abritera plus de la moitié des personnes qui souffrent de manière chronique de la faim dans le monde.
Les mouvements panafricains qui ont succédé à ceux ayant conduit aux indépendances n’ont pas suffi à créer de nouveaux changements majeurs sur le continent. Faut-il remettre en cause le patriotisme de la nouvelle classe des panafricains ? Est-ce plutôt une question de volonté ou de biais à l’inaction ?
Là également il y a une certitude. La facilité à indexer rapidement le joug du néo-colonialisme. Et nous, les jeunes gens, ne nous empressons pas d’entériner cette idée. Tout se passe au-dessus de nos têtes.
Dans les lignes suivantes, je ne ferai pas l’éloge des nombreuses solutions de développement « top down » qui font florès et pourtant, distraient et détournent les jeunes africains, par leur caractère « superficiel ». Au contraire, je défends une approche « bottom-up » du développement socio-économique qui responsabilise et intègre pleinement les jeunes africains. Mais avant, un éclaircissement que je n’ai trouvé dans aucun ouvrage à ce jour me paraît nécessaire.
Un développement socio-économique par les politiciens africains est une fausse bonne nouvelle.
C’est une grande erreur des africains de penser que leurs dirigeants sont élus pour le développement économique.
Dans le système privé, les actionnaires élisent un directeur général pour une durée déterminée avec un contrat défini. Ils lui assignent des objectifs précis, ce dernier s’engage à honorer les engagements du contrat et a l’obligation de résultats. Le directeur général forme une équipe constituée de directeur des ressources humaines, directeur administratif et financier, directeur commercial, etc. Rappelons que le conseil d’administration (les actionnaires) a son mot à dire dans les désignations des autres directeurs.
Soit, les objectifs sont atteints et le système ainsi formé continue son mandat. Soit, dans le cas contraire les actionnaires demandent la démission du directeur général. Ce dernier peut, un tant soit peu contester, se justifier et dans le meilleur des cas aboutir à une solution consensuelle avec un plan d’action clair et réaliste pour corriger son tir. Il ne peut en aucun cas s’imposer. Dans tous les cas, la décision finale ne lui revient pas.
Revenons au système public. Le peuple représente les actionnaires. Le président de la république représente le directeur général, la constitution le contrat qui lie les deux parties. Le gouvernement représente l’équipe et les autres directeurs sont les ministres. Contrairement au système privé, le président de la république une fois élu ne craint plus la sanction du peuple et peut même modifier les clauses du contrat initial. En effet, le peuple sanctionne par le vote. Mais la population africaine ne vote pas sur la base de résultats, le président se contente simplement d’acheter leur voix. Cela veut dire que le système n’incite pas suffisamment le président de la république à avoir de bons résultats. Au contraire, il l’incite à s’enrichir conséquemment (et par tous les moyens possible) pour acheter les voix de la population au prochain vote. Nul besoin de rappeler ici que le président de la république choisit ses ministres sans prendre l’avis direct du peuple ni de ses représentants (le parlement ou tout autre instance de représentation).
Donc, pour parler de développement, il faut croire à l’esprit patriotique du gouvernant. Autrement dit, il faut miser sur sa bonne foi. Mais comment mesure-t-on cette bonne foi ?
Cet éclaircissement fait, j’espère que désormais la jeunesse africaine intègre que le développement dont elle rêve viendra d’elle-même, de sa lutte et de son travail, c’est-à-dire une approche «bottom-up».
Du rêve du développement en Afrique, parlons-en...
L’Afrique se construira autour du rêve africain, c’est évident. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, la jeunesse africaine n’a pas encore défini son propre rêve. La bonne nouvelle, ce n’est pas encore trop tard. Le drame serait de ne pas agir dès maintenant. Ne me dites surtout pas que «L’avenir du monde, c’est en Afrique.», «La force de l’Afrique, c’est sa jeunesse.», ou encore «L’Afrique regorge de toutes les matières premières.» sont des rêves. Ne nous y méprenons pas. A chaque fois, il faut trouver un slogan pour les africains. C’est ça le développement! Et croyez-moi, après le discours sur la croissance démographique en Afrique, il y en aura encore d’autres. Les africains doivent-ils se contenter d’un simple nouveau discours à chaque décennie ? Qu’il nous souvienne, nos pays ne sont toujours pas industrialisés, nous ne disposons pas de centre de recherche et de laboratoires d’envergure pour notre propriété intellectuelle, etc. L’Afrique compte seulement 35 chercheurs par millions d’habitants et aucun pays africains ne parvient à affecter 1 % de son PIB à la recherche. Les discours changent, mais il y a bien une chose qui, malheureusement, ne change guère : notre misère.
La jeunesse africaine doit se prémunir contre une impéritie grave. Sinon, elle perpétuerait une mauvaise tradition.
A lui, ce jeune peuple dont les routes pleines d’angoisses sont pavées de tromperies, de fausses promesses et de misère, nous n’allons pas dire : «Attends, tu auras un jour», mais : «Lève-toi, crée ton rêve, prends tes responsabilités, travaille, et lutte de toutes tes forces pour conquérir la liberté et le bonheur!»
Le programme est à la fois, vague, vaste et complexe. Mais je n’ai jamais promis la facilité non plus.
Lire la publication entière